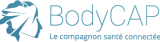La température centrale est un paramètre physiologique jouant un rôle majeur dans le maintien du bon fonctionnement de l’organisme. Cette variable, complexe, est essentielle à la bonne compréhension des interactions entre les processus biologiques tel que le métabolisme, la réponse immunitaire, l’activité enzymatique, les rythmes circadiens, … et les variables du protocole établi.
Dans le domaine spécifique de la recherche clinique, il s’avère très régulièrement primordial d’assurer un suivi fiable, précis et continu de la température centrale des sujets afin de dissocier les variations de température relatives au fonctionnement normal de l’organisme, au comportement de l’individu ou aux aléas de son environnement, des variations propres au protocole mis en place dans le cadre de l’étude.
De l’étude des cinétiques des fièvres à la bonne compréhension de l’évolution des stades infectieux, de de l’évaluation de nouveaux protocoles de prise en charge à l’évaluation de nouveaux médicaments, le suivi de la température centrale est fondamental pour assurer le bon déroulement du protocole de recherche et l’atteinte des objectifs fixés.
Développée par des physiologistes et en étroite collaboration avec des experts internationaux, nos solutions ont été conçues pour allier précision, confort et facilité d’usage. Le système eCelsius Medical permet d’assurer un suivi continu des données de température centrale tout en répondant aux contraintes clés de la prise en charge patient.

Indicateur de l’état de santé
La mesure de la température est une des plus vieilles méthodes connues de diagnostic médical, qu’elle soit réalisée afin de détecter les différentes phases d’hypothermies, d’hyperthermies ou de fièvres. La forte relation entre la température centrale l’homéostasie physiologique et ses perturbations positionne en effet cette variable comme un indicateur clinique majeur de l’état physiologique du patient ; son évolution conduisant souvent à une modification de la prise en charge des patients.
La fièvre est une réponse normale à une infection et sa présence ou son absence peut être utilisée pour évaluer le niveau d’activité d’une infection. Cependant, considérant notamment les différences inter-individuelles liées à l’âge, au sexe, au niveau d’activité physique… et aux évolutions circadiennes de ce paramètre, les données de température centrale doivent être systématiquement interprétées sur la base d’une comparaison intra-individuelle impliquant une mesure répétée ou continue de la variable.
Dans le cadre de protocoles de recherche clinique relatifs à des problématiques virologique, infectiologiques, endocriniennes, … le suivi de la température des patients est une donnée essentielle pour les chercheurs afin d’objectiver l’évolution d’une infection ou d’une inflammation, d’évaluer son intensité et de déterminer l’impact d’une ou plusieurs variables du protocole mis en place. En effet, que ce soit pour affiner la compréhension de la réponse de l’organisme aux agents pathogènes, pour objectiver les effets de nouvelles modalités de prise en charge ou pour quantifier l’efficacité d’un nouveau traitement, un suivi fiable, précis et continu de la température centrale s’avère primordial.
Efficacité et sécurité des médicaments
Dans le cadre du développement de nouveaux médicaments, les essais cliniques ont un double objectif à savoir valider l’efficacité visé du traitement ainsi que son innocuité. La température centrale, indicateur clé de l’état physiologique du patient, est alors un paramètre essentiel de l’étude car il permet de valider le bon fonctionnement du traitement (ex : validation d’un antipyrétique, médicament contre les bouffées de chaleur, …) ou d’attester de « l’absence » d’effets secondaires qui prendraient la forme d’une hyperthermie post prise médicamenteuse ou un trouble du rythme biologique.
En infectiologie, virologie, immunologie, … la surveillance de la température centrale va ainsi viser à valider la réduction de l’intensité ou de l’occurrence des épisodes de fièvre. Dans un autre volet, certains traitements (antidépresseurs, neuroleptiques, antimigraineux, …) vont potentiellement avoir, comme effet secondaire, de provoquer une hyperthermie ou une perturbation des mécanismes de thermorégulation. Le suivi de la température corporelle dans le contexte de l’étude clinique relative à la validation de ces médicaments va alors tenter d’objectiver, de mieux caractériser, les effets secondaires observés et d’affiner les préconisations relatives à la posologie (dosage, heure des prises, …) et aux contre-indications éventuelles (pas d’activité physique poste prise, éviter les prises en cas de forte chaleur, …). Enfin, d’autres traitements vont directement viser ou avoir un effet sur la rythmicité circadienne et ainsi altérer la régulation journalière de la température centrale. L’impact le plus courant prendra la forme de troubles de l’endormissement, une baisse de la qualité du sommeil et de facto de la vigilance diurne. Un suivi fiable, précis et continu de la température centrale s’avère alors primordial pour valider l’efficacité d’un traitement, rechercher ou quantifier l’effet secondaire observé.


Chirurgie et anesthésie/réanimation
Dans le contexte d’une intervention chirurgicale, le suivi de la température centrale est quasi systématiquement réalisé afin de limiter le risque d’hypothermie per opératoire mais également de détecter précocement une dégradation de l’état de santé du patient. En effet, les conditions environnementales du bloc opératoire, le type d’intervention chirurgicale réalisé ainsi que les effets des anesthésiques sur les mécanismes de thermorégulation vont plus ou moins exposer le patient à une diminution de la température corporelle et de fait à un risque d’hypothermie non choisie ; hypothermie ayant elle-même des effets négatifs sur le temps de cicatrisation et de la récupération post opératoire.
De nombreuses études cliniques tentent d’identifier les leviers ou de valider l’intérêt de nouvelles modalités d’intervention pour l’amélioration de la prise en charge des patients. La mesure continue, fiable et précise de la température centrale permet, dans ce contexte, permet d’objectiver l’efficacité du protocole mis en place sur l’amélioration des conditions d’intervention, l’amélioration de l’efficacité des modalités de prise en charge ou l’amélioration de la récupération post-opératoire.


Troubles du sommeil
Le rythme circadien de la température centrale est considéré comme l’un des marqueurs individuels les plus fiable de la rythmicité circadienne. Comme précédemment évoqué, presque toutes les fonctions biologiques de l’organisme sont structurées autour d’un cycle de 24 heures qui permet notamment la régulation de l’alternance veille-sommeil, la libération d’hormones, … La température centrale fluctue classiquement sur une base de 24 h, avec une acrophase aux environs de 18h00, une batyphase comprise entre 04h00 et 06h00 et une amplitude évaluée à 1 °C.
La mesure continue de cette variable permet l’analyse des variations de la température corporelle et la caractérisation du rythme circadien de la température centrale ce qui constitue un outil primordial, notamment pour l’analyse du sommeil et le diagnostic des troubles du rythme et des troubles du sommeil.